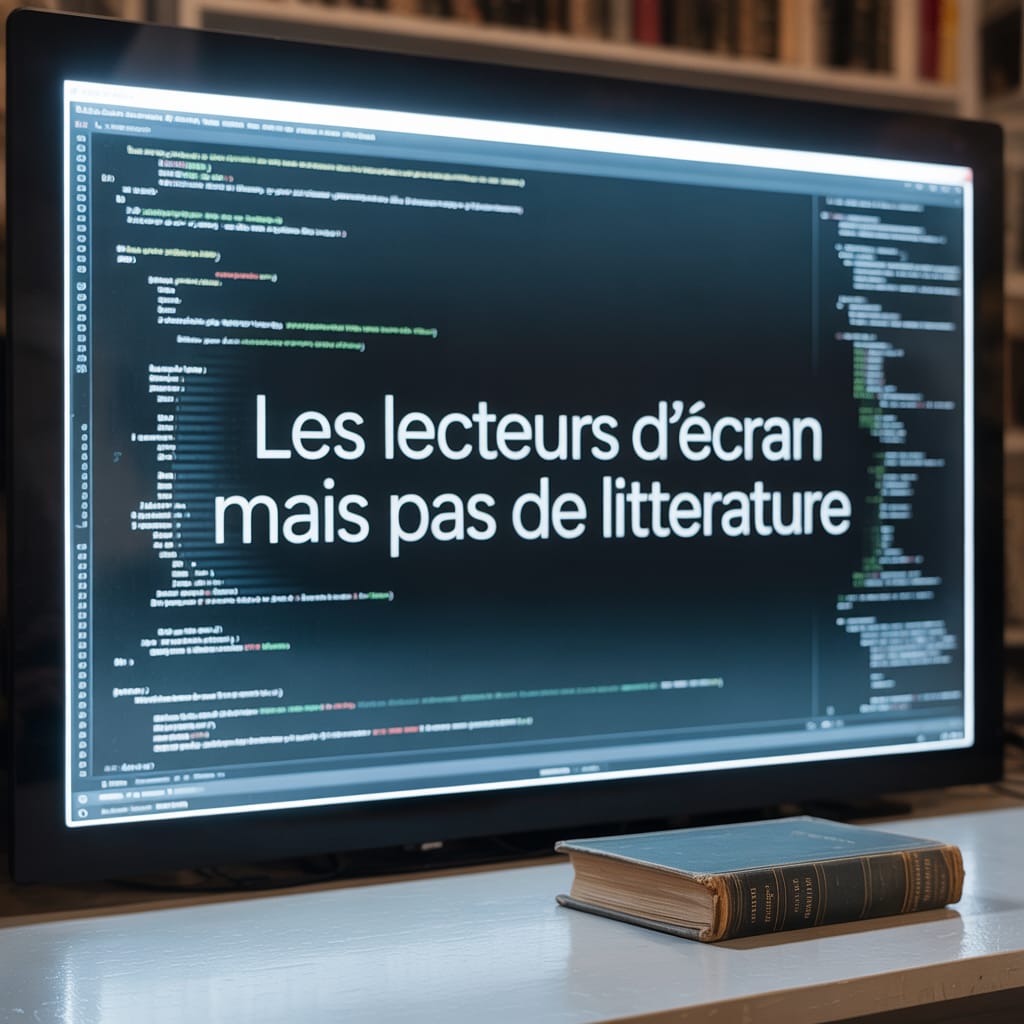Il y a mille manières d’entrer dans un texte, autant de visages que de lecteurs, mais combien, aujourd’hui, franchissent encore le seuil ?
Les cancres? Des funambules du verbe, incapables d’aller au bout d’une idée, papillonnant de promesse en abandon, pareils à ces passants qui lorgnent une vitrine sans jamais oser franchir la porte. La phrase à peine commencée, ils sont déjà ailleurs, le cerveau saturé de distractions, l’âme absente.
Les primates? Eux, se vautrent dans la discipline : obéissance servile à la consigne, satisfaction du devoir accompli, mais l’esprit reste en jachère. Ils cochent la case, déroulent la syntaxe, mais rien ne les touche, rien ne les travaille. Traversée de la page comme on piétine un terrain vague, sans qu’aucune saveur, aucune graine ne sème le trouble.
Le curieux, l’infantile? Lui s’élance sur deux ou trois phrases, s’éblouit, sautille, picore, s’amuse des premières énigmes puis s’évapore dans l’air tiède, laissant derrière lui des épaves de commencements, d’élans brisés, d’intuitions évaporées. L’écume sans la vague.
Mais la cohorte la plus vaste, c’est celle des « voyeurs »,
ceux qui survolent, qui effleurent, qui caressent la surface du texte comme on effleure l’eau du doigt : jamais ils ne plongent, jamais ils n’entrent dans la profondeur.
Il y a ceux qui regardent sans voir, happés par le miroitement de la forme, assourdis par le vacarme du dehors, perdus dans le bal des apparences.
Il y a ceux qui parcourent à toute allure, avalant les lignes avec la gloutonnerie de l’époque, pressés d’arriver mais indifférents à la destination. Lecture à la chaîne, fast-thought, consommation compulsive : le sens leur glisse entre les doigts comme le sable de la distraction universelle.
D’autres s’usent sur la première pente, butant sur le premier relief, déclarant forfait devant la moindre résistance. L’effort les effraie, la densité les rebute : c’est l’échec au premier obstacle, la fuite devant l’exigence.
Et puis viennent les fatigués, les résignés, ceux pour qui la lecture est devenue l’épreuve ultime, le labeur inutile d’un monde saturé de bruit, d’images, d’interruptions, où la patience elle-même semble suspecte, presque obscène.
Très peu, aujourd’hui, vont jusqu’au bout.
Très peu osent traverser le désert du texte, affronter l’hostilité du sens, braver l’ennui, la solitude, l’effort. Très peu consentent à la lenteur, à la répétition, à la rumination, à l’art perdu de la reprise.
Qui s’attarde encore sur une page comme on veille un feu mourant ? Qui prend le risque de la transformation, de l’inconfort, du doute, de l’ébranlement ?
Très rares sont ceux qui, au-delà de la lecture, interrogent, mettent en perspective, croisent les mots avec le monde, fécondent la lettre de leur propre existence.
Lire, vraiment lire, est devenu une prouesse, presque un acte de dissidence.
Dans la foire aux opinions, la patience est ringarde, la profondeur suspecte, la lenteur un crime contre l’époque. L’attention se dissout dans le flux, la pensée cède la place à l’opinion, l’effort à la gratification immédiate.
On lit pour oublier, pour tuer le temps, pour s’endormir l’esprit léger, surtout pas pour penser, surtout pas pour grandir.
Suis-je seul à ressentir ce vertige, ce sentiment d’errance intellectuelle ?
Il y a pourtant, dans cette solitude, une fraternité secrète : celle des résistants, des obstinés, des derniers fidèles, ceux pour qui la lecture reste un territoire de liberté, une ascèse, une lutte contre la médiocrité universelle.
Car c’est là, dans cette fidélité à la page, que se joue, peut-être, la dernière dignité humaine.
Persévérer dans la lecture, c’est refuser l’écrasement du sens, c’est entretenir la flamme sous les cendres de l’oubli, c’est exiger de soi ce que le monde n’exige plus de personne : la concentration, la patience, la capacité à affronter la nuit du texte et le silence du sens.
À l’heure où tout conspire à la dispersion, où chaque écran hurle sa réclame, choisir l’effort, la lenteur, la profondeur, relève d’un insoumission joyeuse.
C’est porter haut, envers et contre tout, l’idée que l’humain ne se résume pas à la pulsion, au réflexe, à la surface.
C’est refuser la paresse généralisée, le contentement bovin, la satisfaction du moindre effort.
C’est se donner la chance d’une renaissance, d’un bouleversement, d’une rencontre, à rebours du troupeau et de ses siestes.
Voilà peut-être la vraie subversion : préférer la conquête rugueuse du sens à la mollesse de l’oubli, revendiquer la solitude, la lenteur, la patience, et rendre à la lecture, dans un sursaut d’orgueil, son vieux pouvoir de sédition, de lumière et de vie.