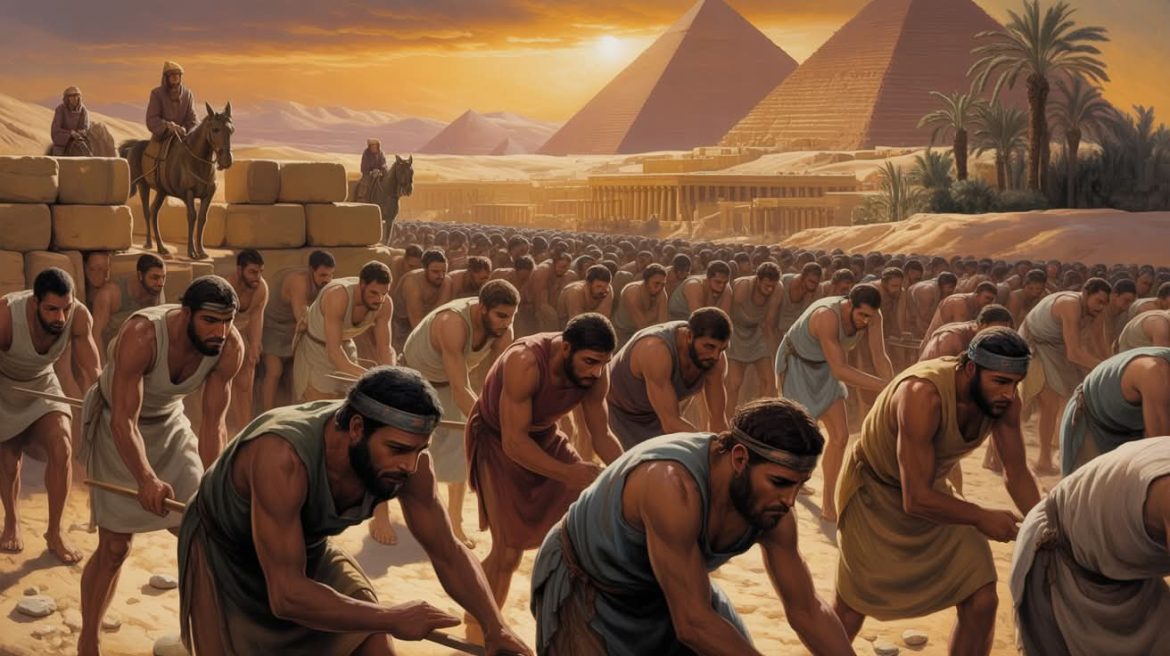Vayéhi n’est pas seulement la clôture de Bereshit ; elle est une méditation sur la vie dans l’exil, sur la transmission du sens et sur la naissance d’une identité capable de résister à la puissance des empires sans s’y dissoudre. La Torah ne conclut pas une histoire : elle fonde une continuité. Le verset d’ouverture, « Jacob vécut en Égypte », est un paradoxe. Comment “vivre” dans le lieu même qui deviendra le symbole de l’asservissement ? Ce verbe n’est pas anodin. Il signifie qu’exister, ici, ne suffit pas : il faut habiter la vie de l’intérieur, préserver la cohérence d’une âme, refuser l’anesthésie du sens. Dans certaines circonstances, vivre devient déjà un acte de résistance spirituelle.
L’Égypte, dans le langage biblique, n’est pas un simple pays : c’est une structure de pouvoir, un système clos. Elle incarne l’ordre, la centralisation, la rationalité du contrôle. Max Weber y verrait l’archétype de la bureaucratie : un monde où l’administration devient le principe de vie, où la technique supplante la finalité morale. La Torah semble pressentir ce que Michel Foucault décrira des siècles plus tard : un pouvoir qui ne se contente plus d’imposer, mais qui modèle les consciences, qui discipline, qui normalise. Le danger n’est plus seulement la contrainte extérieure ; c’est la docilité intérieure. L’exil le plus profond n’est pas celui où l’on te chasse : c’est celui où l’on te fait aimer ta servitude. Le pouvoir suprême est celui qui te persuade que tu es libre.
Et pourtant, Jacob “vécut” en Égypte. Il ne s’y confond pas. Il y habite sans s’y appartenir. Il traverse le monde impérial sans lui donner son âme. Simone Weil parlait d’“enracinement” comme d’un besoin vital : l’homme peut s’épanouir matériellement et pourtant se perdre s’il oublie la source intérieure qui nourrit sa liberté. Jacob apporte au cœur de l’Égypte ce que l’Égypte ne sait pas produire : la mémoire d’une alliance. Il vit dans l’exil, mais refuse que l’exil définisse son être. Sa survie spirituelle est un acte de fidélité : il transforme la mémoire en force de vie.
C’est pourquoi la paracha ne se concentre pas sur la nostalgie d’une fin, mais sur l’acte de transmission. Jacob appelle ses fils pour les bénir. La bénédiction, ici, n’est pas une douceur familiale ; elle est fondatrice. Ce n’est pas de la psychologie, c’est de la politique spirituelle. Jacob ne distribue pas des louanges ; il assigne à chacun un rôle, une fonction, une responsabilité. Là où la modernité rêve d’unité par uniformisation, la Torah propose une unité organique : un peuple ne tient pas parce que tous se ressemblent, mais parce que chacun porte une part du tout. L’unité véritable n’efface pas les différences : elle les ordonne autour d’un sens commun.
On retrouve là une intuition chère à Emmanuel Levinas : l’identité ne vaut que si elle se porte comme responsabilité. Une appartenance qui ne devient pas obligation n’est qu’un narcissisme collectif. Jacob, en bénissant, transforme la filiation en éthique : il fait de la descendance non un privilège, mais une charge. Devenir Israël, ce n’est pas recevoir un nom, c’est porter une tâche. C’est entrer dans une relation de service vis-à-vis du monde et de Dieu.
Cette transmission est aussi une naissance au cœur de la fin. Hannah Arendt nommait “natalité” la faculté d’inaugurer, de faire surgir du neuf dans le monde. Or Vayéhi met en scène ce paradoxe : au moment où Jacob meurt, un peuple naît. Le lit du patriarche devient le berceau de l’histoire. La Torah refuse la fatalité du tragique : elle transforme la mort en commencement. La condition est simple : que la mémoire ne soit pas sentiment, mais responsabilité vivante.
Puis vient le moment mystérieux : « Rassemblez-vous, et je vous dirai ce qui vous arrivera à la fin des jours. » Jacob veut dévoiler l’avenir, mais la parole se tait. La tradition parle d’un voile ; la philosophie y voit une leçon sur la limite du savoir. L’avenir, dans la Torah, ne se livre pas comme information. Hans Jonas dira que le futur n’est pas un objet de curiosité, mais un devoir. Le savoir tue la liberté ; seule la responsabilité la fonde. Le prophétique n’est pas prédire, c’est appeler. L’avenir n’est pas ce qu’on attend : c’est ce qu’on prépare par ses choix.
La scène d’Éphraïm et de Ménaché approfondit cette leçon. Deux enfants nés en Égypte, fils de Joseph, sont adoptés comme tribus d’Israël. Ce geste est immense : il affirme que l’identité hébraïque ne se réduit pas à la biologie, mais repose sur la fidélité. On peut naître ailleurs et entrer dans l’alliance si l’on en partage la promesse. Paul Ricœur parlerait d’“identité narrative” : on devient soi en entrant dans un récit, en assumant une mémoire, en habitant une parole reçue. L’appartenance n’est pas affaire de sang, mais de sens.
Et Jacob croise les mains : le cadet reçoit la primauté. La Torah brise le déterminisme du “droit de naissance”. Elle refuse l’aristocratie naturelle et le pouvoir de l’ordre établi. Le monde aime la hiérarchie du biologique parce qu’elle justifie la domination. La Torah affirme au contraire que la dignité ne s’hérite pas, elle se mérite. L’élection n’est pas privilège, mais exigence : la grandeur se mesure à la responsabilité. Le geste des mains croisées est une pédagogie : la lumière ne se transmet pas selon la chair, mais selon l’esprit.
Le moment le plus radical de Vayéhi réside pourtant dans la demande d’enterrement : « Ne m’enterre pas en Égypte. » Jacob ne réclame pas une sépulture prestigieuse ; il pose un acte de fidélité métaphysique. Il refuse que l’exil ait le dernier mot, même sur son corps. Être enterré en terre d’alliance, c’est affirmer que la vie ne se mesure pas à la sécurité, mais à la vérité de la promesse. L’exil, dès lors, n’est pas qu’un lieu ; il est un état de conscience. Mourir en Égypte, ce serait accepter que le confort remplace la vocation. Jacob choisit la mémoire contre la stabilité, la fidélité contre l’intégration.
Martin Buber aurait dit : la vie vraie se tient dans la relation Je–Tu, dans la parole adressée. Être enterré en Canaan, mais qui plus est, y vivre, c’est maintenir ce dialogue, ne jamais transformer le divin en objet ni soi-même en fonction. C’est affirmer qu’un peuple existe par la relation vivante qu’il entretient avec le sens.
Enfin, Joseph. Homme d’État, stratège, gestionnaire du réel, il parle la langue du pouvoir sans en devenir l’esclave. Il incarne une lucidité sans cynisme. Et c’est lui, le réaliste par excellence, qui conclut sur une parole d’espérance : « Dieu vous visitera, et vous ferez monter mes os d’ici. » Ce n’est pas un vœu pieux, c’est un programme spirituel. Joseph ne dit pas “attendez le miracle”, il dit “préparez-vous à agir”. La pekida, la “visite” divine, désigne un moment où l’histoire exigera une réponse humaine. Ne confondez pas vie et adaptation. Ne faites pas de l’asservissement une norme confortable. La liberté est promesse, mais aussi travail.
Ainsi Vayéhi enseigne une vérité sévère : la véritable sortie d’Égypte commence avant l’exode. Un peuple naît lorsqu’il décide de ne pas s’identifier à la puissance qui le nourrit. L’Égypte peut protéger, organiser, civiliser ; elle peut aussi dissoudre. La Torah en tire une leçon universelle : vivre dans l’empire est parfois inévitable, mais devenir impérial est une faute. La fidélité ne consiste pas à fuir le monde, mais à ne pas se laisser fabriquer par lui.
En cela, Vayéhi rejoint Franz Rosenzweig : Israël n’est pas une donnée ethnique ni un projet politique, mais une forme de durée, un temps habité comme fidélité. L’exil ne détruit pas nécessairement un peuple ; ce qui le détruit, c’est l’oubli de sa vocation. Là où l’empire dissout les singularités dans la puissance, la Torah enseigne une autre persistance : celle d’une mémoire qui devient responsabilité, d’une promesse qui devient chemin, d’une identité qui se maintient non par la force, mais par la fidélité à l’alliance. Vayéhi n’est pas une fin : c’est l’apprentissage d’une éternité vécue au cœur de l’histoire.
© 2025 Rony Akrich — Tous droits réservés / כל הזכויות שמורות / All rights reserved