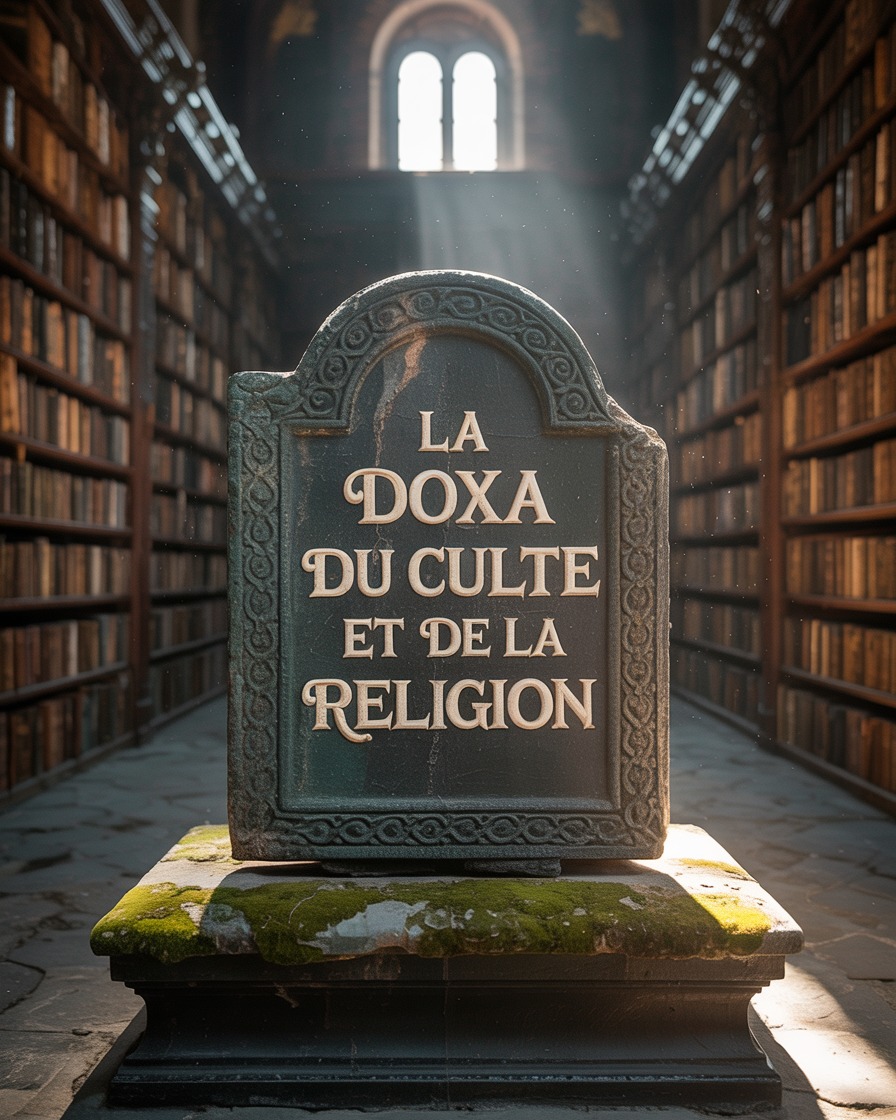Le monde moderne aime croire qu’il s’est émancipé de la religion. Mais l’homme n’a jamais cessé de chercher le sacré. Même dans les sociétés dites sécularisées, de nouveaux cultes ont surgi : culte de la marchandise, du progrès, de la science, des idéologies politiques. De nouvelles religions civiles se sont imposées : celle des droits proclamés sans devoirs, celle de la nation absolutisée, celle d’une humanité abstraite détachée de toute responsabilité concrète. Mais ces substitutions ne nous ont pas délivrés des drames anciens ; elles les ont seulement déplacés. Car le culte et la religion, loin d’être seulement des chemins vers la transcendance, se sont trop souvent retournés en prisons. Deux drames qui, à travers l’histoire, n’ont cessé de se rejouer : celui du geste vide et celui de l’esprit fermé.
Le culte, au départ, est une langue symbolique. Dans la Bible, il est désigné par le terme avodah, le « service » de Dieu, qui n’est pas servitude mais mémoire d’une libération : « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte » (Exode 19,6). Le rite est ici mémoire vivante, geste de gratitude et d’espérance. Les fêtes bibliques sont explicitement mémorielles : Pessaḥ réactualise la sortie d’Égypte, Shavouot rappelle le don de la Torah, Souccot la traversée du désert. La liturgie est un langage qui inscrit dans la chair du peuple une histoire de salut.
Mais très tôt, la critique prophétique surgit. Isaïe dénonce : « Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi » (Isaïe 29,13). Amos va plus loin : « Je hais vos fêtes, je méprise vos assemblées » (Amos 5,21). Le drame du culte est celui de la répétition qui se vide de sens, du geste qui rassure mais n’élève plus. Maïmonide l’avait entrevu dans le Guide des égarés (III, 32) : les sacrifices, disait-il, n’étaient pas une fin en soi, mais un moyen pédagogique pour détourner l’homme de l’idolâtrie. Lorsque le rite est pris pour la vérité, il devient idole. Le culte cesse alors d’être chemin vers Dieu pour devenir écran entre l’homme et Dieu.
La religion, quant à elle, naît du désir de lien, de religare, c’est-à-dire de reliance de l’homme avec le divin, avec les autres et avec le monde. Elle se veut ouverture, tremblement, accueil. Mais l’histoire l’a figée en institution, en appareil, en pouvoir. Kierkegaard dénonçait déjà la « chrétienté » bourgeoise de son temps : un christianisme réduit à une assurance sociale, qui étouffait la foi vivante sous les certitudes de l’État. Nietzsche, plus radical, vit dans la religion instituée le masque de la volonté de puissance, une fabrique de servitude. Sa célèbre annonce de la « mort de Dieu » dans Le Gai Savoir n’était pas une provocation gratuite, mais le constat que la religion dogmatique avait tué la transcendance en la transformant en système clos.
Spinoza, dans son Traité théologico-politique (1670), avait déjà formulé ce diagnostic. Le drame de la religion, disait-il, est de dégénérer en superstition. Là où la loi divine devait enseigner la justice et la charité, elle devient instrument de crainte et de manipulation : « La superstition est d’autant plus forte qu’elle se fonde sur la peur », écrit-il dans la Préface du Traité. Le culte, détourné par les prêtres, devient mécanique d’ignorance ; la religion, confisquée par les Églises, devient pouvoir temporel. Mais Spinoza ne rejette pas l’essence de la foi. Au contraire, il en dégage le noyau : l’amour de Dieu et du prochain, c’est-à-dire la justice et la charité (chapitre XIV). Tout le reste — dogmes, rites, institutions — n’est légitime qu’autant qu’il sert cette fin. Ainsi rejoint-il paradoxalement les prophètes bibliques : « On t’a fait savoir, homme, ce qui est bien : pratiquer la justice, aimer la bonté, et marcher humblement avec ton Dieu » (Michée 6,8).
Levinas, au XXe siècle, prolonge cette critique en la radicalisant. Pour lui, le sens du religieux n’est ni dans l’institution ni dans le rite, mais dans la responsabilité infinie pour autrui. La transcendance se révèle non dans un au-delà spatial, mais dans le visage du prochain, comme il le développe dans Totalité et infini. Cette intuition rejoint les prophètes : l’adoration de Dieu ne vaut que si elle s’incarne dans la justice.
Culte et religion, ainsi corrompus, deviennent nos deux drames. Le culte fige le corps dans le geste vide. La religion fige l’âme dans le dogme clos. L’un sacralise la mécanique, l’autre l’institution. L’un engendre des fidèles assidus mais absents à eux-mêmes, l’autre des croyants persuadés mais sourds à l’Esprit. Deux trahisons d’une même vocation : ouvrir l’homme au souffle de la liberté.
Mais de ces drames peut naître une tâche. Non pas abolir le culte ou la religion, mais les ressaisir dans leur vérité originelle. Le culte doit redevenir mémoire vivante et créativité, geste qui habite la conscience. La religion doit redevenir ouverture, tremblement, accueil de la transcendance. Le prophète l’annonçait déjà : « Je prends plaisir à l’amour plus qu’aux sacrifices, à la connaissance de Dieu plus qu’aux holocaustes » (Osée 6,6). La parole de Jean prolonge, dans le nouveau testament, ce diagnostic : « L’heure vient où ce n’est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père… mais en esprit et en vérité » (Jean 4,21–24). Le cœur du culte, le souffle de la religion, résident dans l’esprit vivant et non dans leurs caricatures.
Le danger moderne est d’avoir cru que l’on pouvait se délivrer de ces drames en rejetant purement et simplement le religieux. En réalité, nous avons seulement changé d’autels. Comme l’avait vu Nietzsche, la mort de Dieu n’a pas supprimé le sacré : elle l’a multiplié sous forme d’idoles profanes, du culte de la technique à celui de la nation. Comme le rappelait Maïmonide, l’homme n’est jamais sans culte ; le seul choix est entre un culte vrai et un culte faux. Comme l’affirmait Levinas, Dieu ne se révèle pas dans l’oppression d’un système, mais dans la vulnérabilité du visage d’autrui. Et comme le proclamait Spinoza, la seule religion universelle est celle qui rend l’homme juste et bon.
Voilà pourquoi notre tâche est d’assumer lucidement ces deux drames, de ne pas s’y résigner, mais de les transformer en vigilance. Le culte ne doit jamais être laissé sans esprit, la religion ne doit jamais être laissée sans éthique. L’homme spirituel est celui qui veille à ce que le rite n’étouffe pas la conscience, et que la foi n’abolisse pas la liberté. Sans cette vigilance, nous retomberons toujours dans les mêmes pièges, en changeant seulement de décor. Avec elle, nous pourrons redonner au sacré sa vocation première : humaniser le monde et ouvrir l’histoire à la transcendance.
Ainsi, culte et religion, loin de rester nos deux drames, pourraient redevenir nos deux bénédictions — si nous acceptons enfin de les purifier de leurs corruptions et de les réconcilier avec ce qui fut toujours leur fin véritable : la justice, l’amour, et la dignité de l’homme libre.