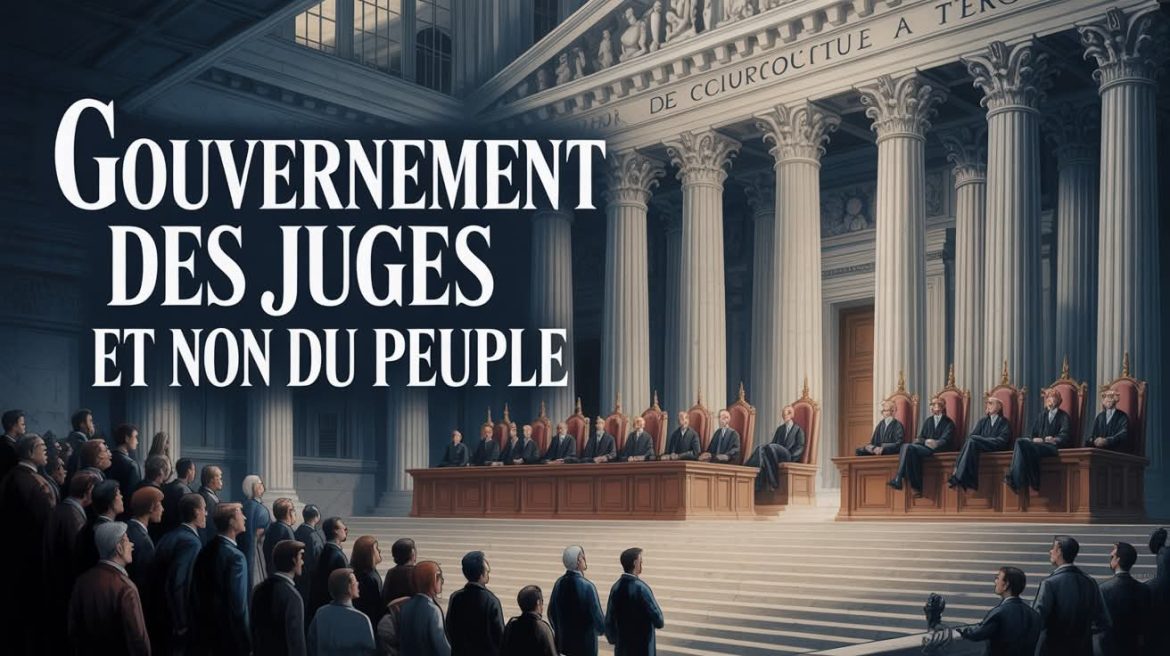Dans les démocraties libérales contemporaines, un phénomène s’impose discrètement mais irrésistiblement: la souvereté ne s’exerce plus uniquement dans l’enceinte du Parlement, mais se déplace vers les cours constitutionnelles, ces instances qui prétendent ne pas gouverner tout en décidant ce qui peut ou non être gouverné. Édouard Lambert, observateur lucide du système américain dès 1921, parlait déjà de « gouvernement des juges » pour désigner ce moment où la loi votée devient secondaire face à l’interprétation judiciaire des principes supérieurs. Ce glissement n’est pas un accident, mais la conséquence logique du constitutionnalisme moderne: on affirme que le peuple décide, puis on ajoute aussitôt « sous réserve de conformité à des valeurs intangibles ». La question devient alors: qui dit ce que sont ces valeurs ? Ce n’est plus l’électeur, ni même l’élu, mais le juge.
Montesquieu imaginait le juge comme « la bouche qui prononce les paroles de la loi ». Mais cette figure a disparu dès lors que, comme le notait James Madison dans les Federalist Papers, la Constitution est conçue non comme un simple cadre mais comme un instrument de contrôle destiné à contenir les excès de la majorité. Le juge cesse alors d’être l’organe d’application pour devenir le gardien d’un ordre supérieur. Carl Schmitt a formulé la conséquence avec une clarté tranchante: « Est souverain celui qui décide de l’état d’exception. » Or, aujourd’hui, celui qui dit qu’une loi votée ne peut pas s’appliquer au nom d’un principe supérieur, celui qui décide de l’exception juridique, ce n’est plus le peuple mais la Cour. La souveraineté, même lorsqu’elle continue d’être proclamée populaire, se trouve en réalité capturée dans l’ombre de la juridiction.
Alexis de Tocqueville avait perçu qu’en démocratie, le danger n’était pas seulement la tyrannie de la majorité, mais aussi la tendance à la passivité, à une recherche de sécurité qui pousse les peuples à déléguer leur responsabilité. Raymond Aron, dans ses analyses lucides du 20ᵉ siècle, voyait déjà dans cette attitude une forme d’auto-limitation : les sociétés libérales préfèrent souvent se lier elles-mêmes par le droit plutôt que d’assumer les risques de la décision souveraine. Friedrich Hayek avertissait que lorsque le droit cesse d’être stable pour devenir interprétatif, il cesse d’être un cadre neutre et se transforme en instrument de pouvoir aux mains de ceux qui savent l’utiliser. La volonté générale devient suspecte, et la loi, un brouillon soumis à validation morale par une élite d’interprètes.
Ce pouvoir judiciaire n’est pas seulement une fonction, il tend à devenir une corporation autonome, au sens que Max Weber donnait à ce terme: un corps protégé, doté de son propre langage, de ses rites, de ses voies d’accès codifiées. Comme l’a montré Pierre Bourdieu, le champ judiciaire fonctionne comme un espace social relativement clos, qui se reproduit par cooptation et homogénéité culturelle. La neutralité qu’il revendique masque en réalité une uniformité de vision du monde. Ce n’est pas un complot, mais un habitus: la magistrature supérieure ne pense pas comme le peuple qu’elle juge, parce qu’elle n’est pas faite de la même expérience historique. Elle ne dépend pas de lui, ne lui rend pas de comptes, ne subit pas la sanction électorale. Elle possède l’autorité sans l’exposition, le pouvoir sans le risque.
C’est ainsi que se forme une nouvelle configuration: les grandes décisions ne sont plus le produit d’un débat public conduisant à un vote, mais d’une confrontation juridique conduisant à une jurisprudence. Aux États-Unis, l’abolition de la ségrégation (Brown v. Board of Education), la légalisation de l’avortement (Roe v. Wade), puis celle du mariage homosexuel (Obergefell v. Hodges) n’ont pas émergé d’un vote majoritaire, mais d’arrêts de la Cour suprême. En France, le Conseil constitutionnel invente des principes comme la « fraternité » pour annuler des lois votées. Dans chacun de ces cas, on dira que le juge a protégé les droits. Mais c’est une autre vérité, plus froide, qui se révèle : le juge a imposé une norme non pas à partir de la loi, mais au-dessus de la loi.
Israël représente à cet égard un laboratoire extrême. Sans Constitution écrite, le Bagatz a élaboré une doctrine d’auto-légitimation fondée sur la prétention à incarner « l’essence de l’État juif et démocratique », formule indéfinie qui permet une extension perpétuelle de son pouvoir. Le « test de raisonnabilité », concept introduit par la Cour elle-même, permet d’annuler une décision non pas parce qu’elle violerait une loi explicite, mais parce qu’elle ne correspondrait pas à l’idée que les juges se font de ce qui est raisonnable pour l’État. Ainsi, une loi votée pour limiter l’ingérence judiciaire dans les nominations a été suspendue non sur la base d’un texte supérieur, mais sur la perception que la Cour a de son propre rôle. Et lorsque l’exécutif décide d’expulser un terroriste ou de légaliser une implantation, il ne se heurte pas à un débat parlementaire, mais à une salle d’audience où ce n’est pas l’intérêt national qui est pesé, mais la conformité à une rationalité juridique autonome.
Ce pouvoir juridictionnel n’est pas neutre parce qu’aucun esprit humain ne l’est. Il est imprégné d’une vision du monde et d’une posture morale. Pourtant, à la différence du législateur, il n’est jamais sanctionné par le peuple. Il possède ce que Weber appelait une autorité charismatique, fondée non sur la tradition ni sur la force, mais sur la croyance en sa compétence et en sa vertu. Derrière cette aura, le rapport de force se renverse: les élus gouvernent encore, mais à condition de ne pas heurter l’interprétation dominante du droit imposée par des juges irrévocables. C’est une souveraineté sous condition, tempérée non par la raison du peuple, mais par la raison d’un corps autonome.
Tocqueville redoutait que les démocraties modernes, par peur de leurs propres excès, finissent par transférer leur pouvoir à une élite morale. Aron observait que les sociétés libérales préfèrent être liées par le droit plutôt que par la décision politique. Et Schmitt nous avertit que refuser d’assumer l’exception, c’est abandonner la souveraineté à celui qui osera l’assumer à notre place. C’est précisément ce qui se produit aujourd’hui: le peuple vote, mais c’est le juge qui autorise ou non l’application du vote. La souveraineté réelle ne réside plus dans l’acte de légiférer, mais dans l’acte de valider.
Ainsi se dessine une forme de tutelle silencieuse: une nation continue de se dire démocratique parce qu’elle vote, mais elle ne se gouverne plus entièrement parce qu’elle ne tranche plus. Le droit, devenu surplomb moral, remplace la décision politique. Le gouvernement des juges n’est pas un complot ni une usurpation brutale, c’est le résultat d’une civilisation qui doute de sa propre capacité à décider et préfère s’en remettre à la prudence juridictionnelle plutôt qu’au risque de la souveraineté. La démocratie ne meurt pas par violence, mais par inhibition. Elle ne s’effondre pas, elle se fige. Elle ne cesse pas de parler de droit, mais elle cesse de produire du politique. Et lorsque, au nom de la raison juridique, une société renonce au risque de la décision, elle ne devient pas plus juste, elle devient simplement plus immobile.
Bibliographie
• Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, éd. GF/Flammarion ou Gallimard.
• Édouard Lambert, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis, Paris, Marcel Giard, 1921.
• James Madison et al., The Federalist Papers, 1787–1788, trad. fr. Le Fédéraliste, GF-Flammarion.
• Carl Schmitt, Théologie politique, trad. fr., Gallimard, coll. « Tel », 1988.
• Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 2 vol., 1835–1840, éd. GF ou Gallimard « Quarto ».
• Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, Paris, Gallimard, 1965.
• Friedrich A. Hayek, Droit, législation et liberté, trad. fr., PUF, 3 vol., 1973–1979.
• Max Weber, Économie et société, trad. fr., Plon, 1971.
• Pierre Bourdieu, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 64, 1986.
• Hans Kelsen, La garantie juridictionnelle de la Constitution (La justice constitutionnelle), trad. fr., Bruylant, 1928.
• Aharon Barak, The Judge in a Democracy, Princeton University Press, 2006.
© 2025 Rony Akrich — Tous droits réservés / / All rights reserved