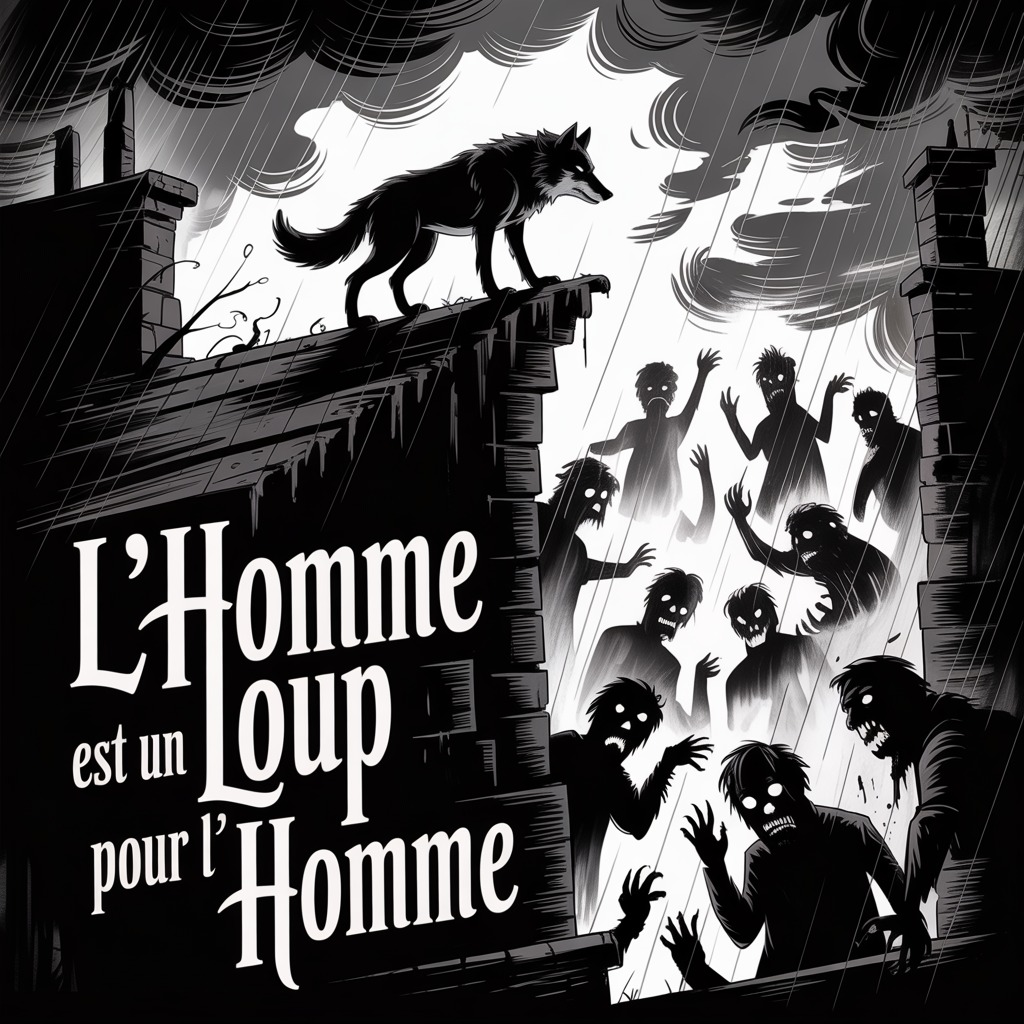L’homme ne changera pas. Ou du moins, rien ne prouve jusqu’à présent qu’il le désire sincèrement. Il est devenu maître dans l’art de se maquiller en victime et en ange, mais le masque tombe vite quand la faim, l’orgueil, l’intérêt ou la peur s’en mêlent. Depuis l’origine, il semble habité d’un désir de dépassement qui ne connaît pour limite que son incapacité à se dépasser lui-même. Il convoite, jalouse, frappe, dissimule, élimine, non par accident, mais par inclination. Dès la Genèse, le diagnostic est posé avec une clarté que nul optimisme ne saurait effacer:
« L’Éternel vit que les méfaits de l’homme se multipliaient sur la terre, et que le produit des pensées de son cœur était uniquement, constamment mauvais; » (Genèse 6,5).
Le cœur humain, ce cœur dont tant de romantismes ont chanté la noblesse, est présenté ici non pas comme corrompu par l’extérieur, mais comme la source même du mal. La Bible ne propose pas une anthropologie angélique. Elle se tient, comme disait Lévinas, au seuil du tragique, là où l’homme est libre et donc coupable. Le mal ne se réduit pas à une abstraction, mais il s’intègre à l’économie intérieure de la liberté humaine.
Même après le Déluge, Dieu ne rétracte pas ce jugement. Il le confirme avec une nuance terrible :
« Désormais, je ne maudirai plus la terre à cause de l’homme, car les conceptions du cœur de l’homme sont mauvaises dès son enfance… » (Genèse 8,21).
L’innocence originelle n’existe pas, l’état de grâce n’a pas été perdu par accident. L’homme est un être en tension, capable du bien, mais incliné vers le mal. C’est cette conscience aiguë du mal qui hante toute la tradition juive, non comme malédiction, mais comme point de départ éthique.
Le Talmud en tire un enseignement fondamental:
« J’ai créé le mauvais penchant, et j’ai créé la Torah comme antidote » (Kidouchin 30b).
Le mal n’est pas effacé ; il est encadré, orienté, sublimé si possible. Mais il ne disparaît jamais. Et lorsqu’il est laissé sans contrepoids, il devient domination, violence, cruauté, ou, plus subtilement encore, indifférence. Hannah Arendt a nommé cela avec effroi : la banalité du mal. Non pas le mal des monstres, mais celui des hommes ordinaires qui cessent de penser, qui obéissent, qui suivent, qui ferment les yeux.
Et pourtant, malgré la profondeur du mal, nous persistons à espérer. À imaginer que l’homme pourrait devenir bon, qu’il pourrait se hisser vers un humanisme pacifié. Nous écrivons des traités de droits, des constitutions, des chartes, des traités de paix. Nous fondons des institutions, nous bâtissons des écoles, nous répétons que « plus jamais ça ». Mais le « jamais » revient toujours. Auschwitz n’a pas suffi. Hiroshima non plus. Le Rwanda, la Bosnie, l’Ukraine, les pogroms modernes, les massacres d’innocents, les kamikazes, les enfants violés, les femmes réduites en esclavage, les foules haineuses, les réseaux avides et le 7 octobre, tout cela revient. Cela se produit de manière plus perfectionnée, plus globalisée. Ce que Camus appelait la « peste », ce virus de l’âme humaine, ne meurt jamais.
Ici, je ne cherche pas à condamner seulement le fait religieux, je dois aussi avoir l’honnêteté de dire que la foi, elle aussi, a souvent trahi son nom. Les croisades, l’inquisition, les fatwas, les purges, les pogroms et les excommunications ne furent pas le fruit du doute, mais celui d’une foi devenue pouvoir. Kierkegaard, chrétien sincère, écrivait déjà : « Dès qu’une institution devient religieuse, elle devient ennemie de Dieu. » Ce que Dieu attend, ce n’est pas la soumission, mais la justice, le cœur brisé, la responsabilité. Et cela, disait déjà Isaïe,
» Le Seigneur a dit: « Puisque ce peuple ne me rend hommage que de bouche et ne m’honore que des lèvres, et qu’il tient son cœur éloigné de moi, et que sa piété à mon égard se borne à des préceptes d’hommes, à une leçon apprise » (Isaïe 29,13).
Et Dieu lui-même, à travers le prophète :
» Je hais, j’ai en dégoût vos fêtes, je ne prends nul plaisir à vos assemblées. Quand vous m’offrez des holocaustes et des oblations, je ne les agrée point; je n’ai point de regard pour votre tribut d’animaux gras. Faites-moi grâce du bruit de vos cantiques, que je n’entende plus le son de vos luths! Mais que le bon droit jaillisse comme l’eau, la justice comme un torrent qui ne tarit point! » (Amos 5,21-24).
Et la philosophie ? Elle a produit des sommets de pensée, mais elle aussi a souvent échoué à se faire vie. Elle a enseigné la tempérance, mais nourri les élites dominantes. Elle a chanté l’humanité, mais laissé faire l’histoire. Elle a offert des stoïcismes sublimes, des éthiques de la responsabilité, mais la majorité des hommes n’en ont rien su. L’impératif catégorique de Kant n’a pas empêché les chambres à gaz. L’amour du « Logos grec » n’a pas empêché l’esclavage. La dialectique hégélienne n’a pas empêché le goulag. La raison elle-même, quand on ne la tempère pas avec la sagesse du cœur, devient une arme froide.
Pourtant, des voix courageuses ont refusé de céder : le Maharal, qui vit dans le chaos humain un appel à l’unité divine ; Yehouda Halevi, qui plaida pour une existence réconciliée entre foi et sol ; Lévinas, qui fit du visage humain un Sinaï miniature. Simone Weil, qui perdit la parole pour mieux entendre le silence des souffrants. Camus, qui choisit l’honneur des hommes contre les justifications du système. Arendt, qui persista à penser là où tant d’autres avaient abdiqué. Ces voix n’ont pas transformé l’humanité, mais elles l’ont empêchée de sombrer entièrement dans le mensonge.
On doit cesser de croire que l’homme changera, on doit cesser de flatter sa conscience, on doit le regarder en face, dans sa violence, dans sa lâcheté, dans sa dureté, mais aussi, dans sa capacité de refus. Dans ce point fragile où, face au mal, un homme dit non, non au meurtre, non au mensonge, non à la haine. Ce « non » n’est pas spectaculaire, il ne sauve pas le monde, mais il sauve l’âme.
Comme le dit le prophète Jérémie :
« Le coeur est plus que toute chose plein de détours, et iI est malade: qui pourrait le connaître? » (Jérémie 17,9).
Et pourtant, Dieu ajoute : « Moi, l’Éternel, je sonde le cœur ». Cela signifie que, malgré tout, un regard continue à scruter l’homme, à l’interroger, à l’appeler, à le faire sortir de sa torpeur.
L’homme ne veut pas devenir ange, et l’ange ne peut devenir homme. Mais entre les deux, l’homme fidèle existe, celui qui, sans croire à la victoire, refuse de trahir le combat. Il n’espère plus naïvement, mais il ne renonce pas, il veille, il garde un feu, même sous les cendres. Il refuse d’ajouter une goutte à l’océan de haine, il refuse de devenir complice. Il sait que la paix n’est pas l’état naturel de l’homme, mais il la cherche comme un miracle quotidien.
Cela ne s’appelle peut-être plus « espoir ». Cela s’appelle dignité. Ou peut-être : lucidité fidèle. Ce n’est plus croire en l’homme. C’est croire que, même sans y croire, on doit agir comme s’il en valait encore la peine.