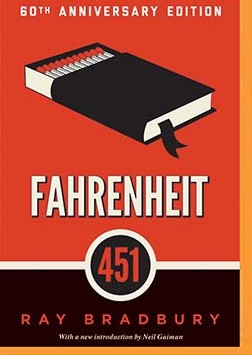La littérature fantastique nous renseigne sur nous-mêmes, tandis que la littérature dystopique nous avertit de ce que nous pourrions devenir.
Dans Fahrenheit 451, le livre prophétique de Ray Bradbury, nous reconnaissons qui nous sommes, ce que nous sommes devenus au cours des sept dernières décennies et ce qui nous attend, peut-être, dans le futur.
En 1953, à l’époque où il n’y avait pas de télévision dans chaque foyer et où le divertissement principal était la lecture de livres, Bradbury a prédit avec précision qu’à l’avenir, l’Humanité serait accro au « temps d’écran » – à un visionnage excessif de séries et un regard prolongé sur les écrans. Une réalité qui déconnectera les gens du passé culturel et historique, de la sagesse des générations, et les connectera à des messages courts et superficiels transmis à la télévision, à la radio et en général – dans les médias.
« La télévision est ‘réelle’, elle est immédiate, elle a des dimensions », explique l’un des personnages. « Elle te dit quoi penser et te l’inculque. Ça doit être la vérité. Ça semble si réel. Elle te tire si vite vers ses conclusions que ton cerveau n’a pas assez de temps pour protester ».
Bradbury dépeint cette réalité à travers une femme nommée Mildred. Elle passe le plus clair de son temps à s’évader dans une réalité virtuelle – à regarder sa télévision géante à écran plat qui s’étend sur trois murs dans le salon. Mildred « vit » les personnages apparaissant dans ses séries préférées et s’imagine qu’elle est actrice dans l’une d’entre elles. Lorsqu’elle ne regarde pas la télévision, elle écoute la radio et la musique avec ses écouteurs, semblables aux IPod utilisés par la plupart des gens aujourd’hui, même si son mari lui parle.
En fait, Mildred est incapable de tenir une conversation significative, car elle n’a vraiment aucun sujet de conversation, autre que sa série, et même dans ce cas, les descriptions qu’elle fournit sont plutôt vagues.
La dépendance de Mildred lui sert de plaisir éphémère, la distrayant de la vraie vie. « C’est vraiment amusant », dit-elle à son mari avec un visage impassible. « Ce sera encore plus amusant quand nous pourrons nous permettre d’installer un quatrième mur [pour les écrans] ».
Aujourd’hui, il semble que Bradbury ait prévu l’avenir, car il s’agit d’une réalité réelle, ou d’une réalité qui fait peau et nerfs, pour un bon nombre.
Mais Bradbury ne s’est pas arrêté là, il a mis en garde contre une autre phase, à peine lointaine, dont nous voyons aujourd’hui le début – l’aversion pour les nombres. Au fil des années, prédit-il, de moins en moins de gens seraient intéressés à les lire.
Après tout, pourquoi s’embêter à lire des livres, quand on peut obtenir toutes les informations en courts segments à la télévision ou à la radio, 24 heures sur 24, ou à l’aide d’une requête à la nouvelle intelligence artificielle ?
Bradbury décrit l’évolution qui a conduit à cela : au début, « les classiques ont été raccourcis pour s’adapter à des programmes de radio de 15 minutes, puis ils ont été à nouveau raccourcis pour s’adapter à une chronique de deux minutes sur un livre. Enfin, ils ont été résumés dans un dictionnaire, en 10 ou 12 lignes.
» La seule connaissance que les gens avaient de Hamlet de Shakespeare, par exemple, provenait d’un « synopsis d’une page ».
De cette façon, le sens et la profondeur, ainsi que l’impact intellectuel et émotionnel de l’œuvre, ont été distillés dans des « bribes d’information » faciles à digérer qui incluent une connaissance superficielle de l’œuvre, comme les flashbacks publiés dans les médias. , ou les publications sur les réseaux sociaux.
C’est le système d’éducation qui a soutenu cela.
Bradbury avait prédit l’existence d’écoles technologiques, où l’apprentissage se fait en regardant uniquement des programmes numériques, sans livres. Un peu similaire aux écoles existantes en Israël où l’apprentissage se fait via des iPads. Bien sûr, dans Fahrenheit 451, l’évolution technologique est à un stade plus avancé, et les enfants n’ont pas un enseignement en présentiel mais un « professeur filmé » (à travers un écran). L’accent est mis dans les leçons sur « comment faire les choses » et non sur « pourquoi ». Les contenus deviennent épars et superficiels au fil des années, pour éviter toute souffrance d’apprentissage.
Guy Montag, le héros du livre, est pompier. Son métier ne consiste pas à éteindre des incendies, mais à brûler des livres : Bible, écrits de Marc-Aurèle, écrits de Mahatma Gandhi et les Voyages de Gulliver, tout est jeté au feu. Une nuit, il arrive chez une femme âgée. Avec son équipe ils sont appelés sur les lieux, un des voisins les avait informés qu’elle gardait des livres chez elle. Dans une scène rappelant la Gestapo pendant l’Holocauste, ils entrent avec leurs lance-flammes, versent du kérosène dans toute la maison et se préparent à la brûler jusqu’au sol. Cependant, la femme âgée refuse de laisser ses livres et choisit finalement de rester et de brûler vive dans sa maison.
Son regard si convaincu oblige Montag à commencer à se poser des questions. « Il doit y avoir quelque chose dans les livres », dit-il à sa femme Mildred, qui ne veut pas vraiment l’entendre. « Des choses qu’on ne peut pas imaginer, des choses qui feraient qu’une femme reste dans une maison en feu. Il doit y avoir quelque chose, les gens ne restent pas pour rien ».
À l’instar de Bernard Marx dans » Le Meilleur des mondes » d’Aldous Huxley, et Winston Smith dans « 1984 » d’Orwell, Guy Montag commet une grave erreur – il se met à réfléchir. Il s’interroge sur les aspects de la société qui défient le courant dominant et finit par se rendre compte que la suppression des livres et des idées qu’ils contiennent ne sont que le symptôme d’un problème plus vaste : les humains ont cessé d’être des humains. Ils ont cessé d’êtres humains.
Comme Mildred, la vie de nombreux membres de la société est un divertissement passif devant l’écran, sans lien significatif, et seuls quelques-uns vivent leur vie dans un but moral.
Leur intellect, leurs émotions et leur créativité ont été opprimés et asservis par les médias, qui en fin de compte servent un certain parti politique (pour Bradbury, c’est le « grand gouvernement »).
Il n’y a aucune raison, aucun sens et aucun but à la vie. Il n’y a que du plaisir et de l’amusement à regarder la télévision, écouter des podcasts ou conduire à une vitesse supérieure à la limite légale. C’est du nihilisme.
Le bonheur durable, en revanche, ne peut être atteint que par la culture de l’âme et de l’esprit – quelque chose qui exige d’une personne d’avoir un objectif moral. Mais les citoyens de « Fahrenheit 451 » n’ont aucune compréhension de Dieu ou de la moralité. Ils passent simplement d’un plaisir éphémère à un autre, jusqu’à ce qu’ils meurent et que leurs corps soient brûlés.
« Dix minutes après sa mort, une personne n’est plus qu’un grain de poussière noire », explique-t-on. « Ne brûlons pas la mémoire de ces gens, oublions-les, brûlons tout, brûlons tout ».
Après l’inspection de Montag, il « s’arme » d’un exemplaire de la Bible et rejoint un mouvement de résistance d’hommes qui s’engagent à se souvenir du contenu des livres importants, afin qu’ils puissent eux-mêmes servir de « transmetteurs de culture ».
Le message de l’œuvre est clair – si la société contemporaine continue à suivre le chemin de la dépendance aux écrans et aux messages rapides et superficiels, elle pourrait se détériorer en une société nihiliste et vide, principalement occupée à son propre divertissement.
Les gens vont abandonner la Foi ou la recherche de sens à la vie, au profit d’un visionnage excessif de leurs « émissions préférées », d’un surf incessant sur les réseaux sociaux, et de la perte de leur temps sur les jeux informatiques.
Bradbury a averti que nous risquions de devenir des « Mildreds », ou en termes plus simples – des personnes inhumaines.