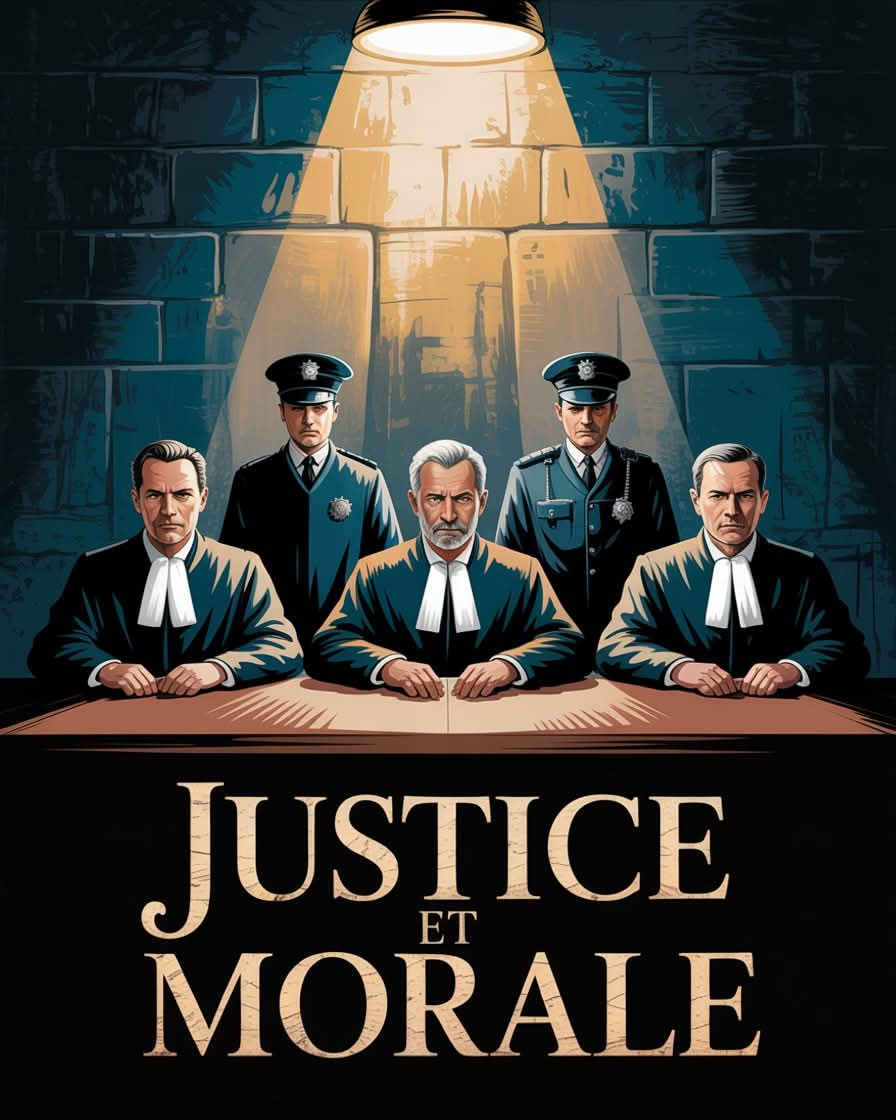La paracha Choftim, dans le livre du Deutéronome, fait partie des sections centrales de la Torah politique. Elle ne se contente pas d’énoncer des commandements et des lois, mais elle pose les principes fondateurs d’une société morale. Le verset « Justice, justice tu poursuivras » (Deut. 16,20) établit non seulement une obligation formelle, mais un objectif philosophique : la justice n’est pas une évidence, elle exige effort, poursuite, labeur. Dans le traité Sanhédrin (32 b), les Sages enseignent que la répétition d’un mot signifie qu’on ne peut pas utiliser la perversion pour arriver à un résultat positif. La voie menant à la justice doit être elle-même juste. Le texte biblique pose ainsi une exigence plus élevée : non seulement la loi doit exister, mais son application doit également respecter des critères moraux. Cette idée évoque la vision d’Aristote sur la justice en tant que vertu globale, ainsi que la pensée de Kant, qui affirme que la raison pratique incite l’être humain à agir conformément à une règle morale universelle.
La paracha esquisse une structure complexe d’institutions : juges et policiers dans chaque cite, prêtres et lévites, prophète et roi. Cette répartition apparaît comme l’amorce d’une théorie de l’équilibre des pouvoirs : on évite la concentration du pouvoir dans une seule institution, mais on compte plusieurs pôles pour prévenir la tyrannie. Montesquieu a soutenu que la séparation des pouvoirs est une condition de la liberté ; or nous trouvons déjà dans la Torah le principe de la dispersion de la puissance. Nahmanide, dans son commentaire, relève que le verset oblige à nommer des juges dans chaque ville, car la justice doit être présente dans la vie quotidienne et non concentrée uniquement à Jérusalem.
La question de la royauté est particulièrement complexe. La Torah ordonne : « Tu établiras sur toi un roi » (Deut. 17,15), mais aussitôt, il limite : qu’il ne multiplie pas les chevaux, les femmes, l’or, l’argent, etc., et qu’il écrive pour lui un rouleau de la Torah. C’est là une dialectique subtile entre le besoin politique d’un ordre stable et la crainte morale de la tyrannie. Dans les Lois des Rois, Maïmonide décrit le roi comme étant au cœur d’Israël, mais il souligne qu’il doit se plier à la Torah. Cette vision préfigure celle de John Locke, qui mettait en garde contre une monarchie non régie par la loi. Elle contraste également avec celle de Thomas Hobbes, qui considérait la monarchie absolue comme un gage de stabilité. L’inscription manuscrite de la Torah par le souverain est un signe symbolique : la loi demeure constamment à l’avant-plan, sa force ne dépend pas de sa puissance, mais de sa loyauté envers la loi.
En parallèle, la Torah définit l’autorité du tribunal de Jérusalem : « Tu agiras selon la parole qu’ils t’annonceront » (Deut. 17,10). Les Sages l’ont compris comme conférant un pouvoir absolu au Sanhédrin. On y retrouve une tension philosophique fondamentale : d’un côté, la Torah est éternelle ; de l’autre, l’homme l’interprète. Saadia Gaon écrivait que notre peuple n’est une nation que par sa Torah, et or la Torah ne se maintient pas sans interprètes qui l’actualisent à chaque génération. C’est un dialogue permanent entre le divin et l’humain, entre la permanence et l’histoire. Leo Strauss y voyait un fondement de la politique juive : la raison n’abolit pas la révélation, mais la commente, créant ainsi un espace de responsabilité humaine à l’intérieur de la loi divine.
Face aux institutions stables se dresse la figure du prophète. Sa fonction n’est pas juridique, mais morale : porter une voix de conscience, y compris contre le pouvoir. Le prophète Samuel, par exemple, réprimande le peuple pour sa demande d’un roi (1 Samuel 8), et Jérémie s’oppose aux prêtres et aux faux prophètes en dénonçant la corruption. La fonction prophétique agit comme une voix marginale, critique, parfois subversive, un rappel que la loi peut se corrompre si elle n’est pas examinée à la lumière de la justice supérieure. Le prophète en Israël n’est pas seulement un complément de la loi, il en révèle aussi les failles. Martin Luther King, qui évoluait dans une société démocratique moderne, a reformulé cette vérité ancienne : parfois la loi formelle est immorale, et alors la conscience oblige à la briser pour revenir au fondement de la justice. La Torah institue ainsi une architecture complexe où la prophétie complète la loi et préserve sa dimension critique interne.
L’ordre de nommer juges et officiers « dans toutes tes portes » exprime une responsabilité collective : la justice n’est pas une affaire élitiste de centres de pouvoir, mais une présence requise dans chaque communauté. Chaque ville et chaque foyer doivent disposer d’un dispositif judiciaire, car la société entière est responsable d’assurer la justice. Cela correspond aux propos de Maïmonide dans les Lois du Sanhédrin, où il affirme que la réglementation d’une petite ville est identique à celle d’une grande ville, et qu’on doit partager l’obligation légale. Aristote voyait dans la « polis » une communauté morale et non seulement une organisation d’intérêts, et la Torah, ici encore, cherche à faire de la justice un mode de vie collectif et non un simple instrument administratif.
Finalement, la section biblique intitulée « Choftim » ne se limite pas à des lois, mais constitue plutôt un document politique et philosophique. Elle proclame que la justice est une valeur suprême à atteindre. Elle cherche à établir un équilibre des forces pour éviter la domination. Elle admet la nécessité d’un leadership politique, mais elle le soumet à certaines restrictions. Elle requiert l’allégeance à la législation, tout en laissant une marge d’interprétation humaine. De plus, elle érige la prophétie en guide moral, tout en imposant à chaque groupe social une responsabilité active dans la quête de la justice. De ce fait, elle pose les bases conceptuelles d’une société juste et éthique. Elle anticipe de plusieurs siècles les questionnements qui animeront la philosophie politique occidentale : comment concilier respect de la loi et liberté individuelle ? Comment établir des institutions sans négliger la conscience ? Comment construire un État qui ne mette pas la moralité de côté au profit du pouvoir ?