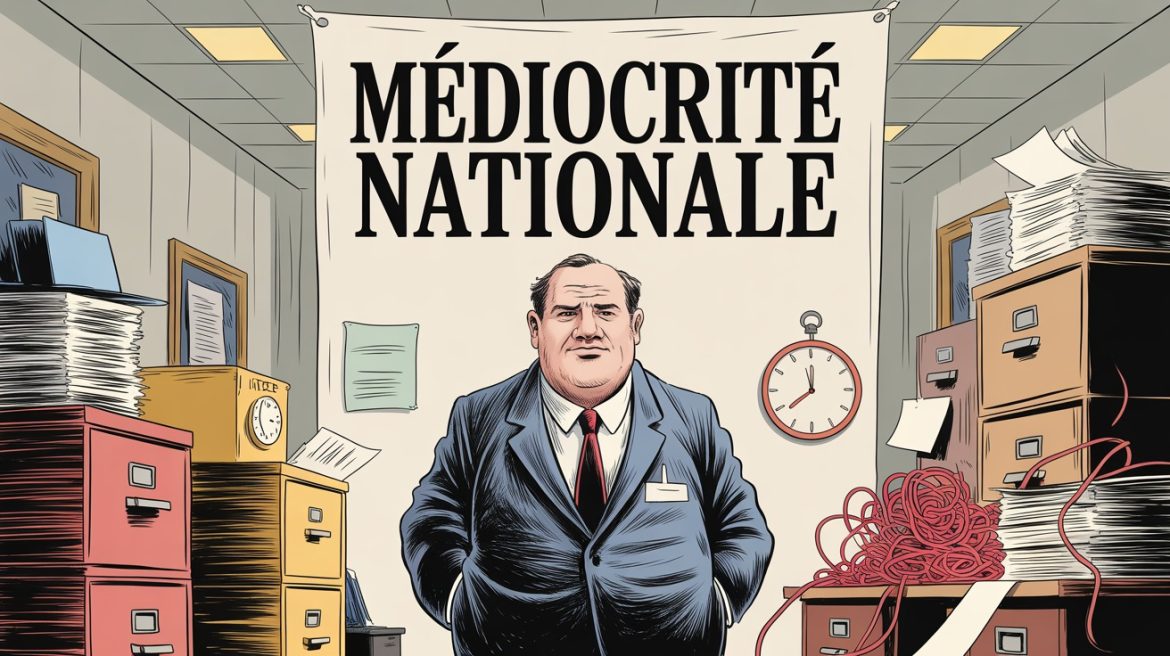Les mots de Yaakov Hazan: « Nous voulions élever une génération d’ esprits libres, et nous avons enfanté une génération d’ ignorants » résonnent aujourd’hui comme une prophétie accomplie. Ils traversent les décennies et viennent frapper au cœur même de notre crise spirituelle : celle d’un peuple qui a voulu se libérer de la foi, sans comprendre qu’on ne se libère pas du souffle qui fonde la vie. La laïcité, en rejetant le joug du sacré, a trop souvent rejeté aussi la sève du sens ; et la religiosité, en s’accrochant aux formes, a perdu le feu. Deux mondes se font face, miroirs brisés d’une même déchéance : l’un a troqué la profondeur contre la liberté ; l’autre, la liberté contre la soumission. La première s’abrite derrière de nobles mots, humanisme, égalité, tolérance, que plus personne ne médite ; la seconde s’enferme dans les gestes du culte, persuadée que l’obéissance tient lieu d’amour. Ainsi, l’homme moderne flotte entre deux néants : il ne croit plus, mais ne pense pas davantage. L’ hérétique véritable suppose une connaissance ; le croyant véritable, une conscience. Nous n’avons ni l’un ni l’autre, seulement des ombres bavardes, animées par la peur et la distraction. Retrouver la flamme, ce n’est pas revenir en arrière : c’est rendre à la liberté sa profondeur, et à la foi son intelligence. C’est replacer l’esprit au centre, là où l’homme se tient debout, non pour adorer, ni pour renier, mais pour comprendre.
Il existe en Israël des esprits d’exception, des individus qui, par leur travail, leur étude, leur courage intellectuel, portent encore la flamme de la pensée. Mais ces figures demeurent isolées, comme des oasis perdues dans un désert où dominent désormais les slogans, les petites phrases et les carrières recyclées. La sagesse des individus ne peut pas remplacer une culture collective. Et une culture partagée ne se bâtit pas par hasard : elle exige transmission, effort, exigence, institutions qui la soutiennent et un peuple qui en comprend la nécessité. Israël, aujourd’hui, ne souffre pas seulement d’une crise politique : il souffre d’un appauvrissement de l’esprit.
La démocratie israélienne est rongée par une dérive inquiétante : la politique est devenue une scène où journalistes, généraux à la retraite, commentateurs de plateau et juristes médiatiques se bousculent pour obtenir un siège. Non pas par le long travail du militantisme, non pas par la conquête difficile de la confiance des citoyens, mais par le raccourci de la célébrité, de l’autorité militaire ou de la notoriété médiatique. Le suffrage universel, censé être l’expression vivante du peuple, se vide de son sens lorsqu’il est confisqué par des figures de prestige imposées d’en haut. Le résultat est clair : nous avons cessé d’élire des représentants du peuple pour élire des images. L’élu d’hier, qu’on l’approuve ou non, portait un projet, une idéologie, un engagement ; il avait sillonné les villes et les villages, dialogué avec les citoyens, forgé une pensée. L’élu d’aujourd’hui est trop souvent un produit prêt-à-consommer : un ancien chef d’état-major transformé en « homme d’État », un chroniqueur de télévision devenu « défenseur de la démocratie », un ex-patron du Shin Bet métamorphosé en « garant de la sécurité nationale ». Le peuple ne choisit plus, on lui propose un casting. Cette dérive n’est pas neutre. Elle entraîne un nivellement par le bas de toute la vie publique. La politique, au lieu de s’élever vers une vision, s’aplatit dans la gestion immédiate et la communication. Elle ne pense plus : elle réagit. Elle ne construit plus : elle occupe l’espace médiatique. Le triomphe de l’instantanéité et du spectacle a remplacé le temps long des idées. La politique israélienne, qui aurait dû être une école de grandeur et de lucidité, s’enlise dans une médiocrité satisfaite d’elle-même.
Cette médiocratie n’est pas le fruit du hasard. Elle est le produit direct de l’appauvrissement culturel. Car une démocratie ne survit pas sans culture. Et une nation ne peut affronter ses épreuves sans une conscience profonde de son histoire, de ses sources, de ses textes et de ses savoirs. Israël s’est construit sur l’étude : celle de la Torah et des Prophètes, celle du Talmud et des penseurs médiévaux, celle des grandes œuvres de la culture universelle qui enrichissaient la pensée juive au fil des siècles. L’héritage d’Israël n’est pas seulement militaire ou diplomatique : il est avant tout intellectuel et spirituel. Mais cet héritage a été relégué aux marges. Aujourd’hui, rares sont les dirigeants capables de citer Isaïe ou Jérémie autrement que comme ornement rhétorique. Rares sont ceux qui ont lu Maïmonide, Spinoza, ou Levinas, et qui savent penser la politique à partir de leurs leçons. Rares, aussi, ceux qui connaissent les classiques de la philosophie universelle : Platon, Aristote, Kant, Hegel. Comment prétendre gouverner un peuple si l’on ignore ce que signifie la justice pour Platon, la liberté pour Kant, ou la conscience tragique pour Dostoïevski ? Comment diriger une nation au XXIe siècle sans comprendre les fractures nées des deux guerres mondiales, de la Shoah, des totalitarismes, sans maîtriser la mémoire des idées qui ont façonné l’Europe, l’Orient et l’Occident ? Une société sans mémoire, sans savoir et sans culture générale devient une société manipulable. L’ignorance collective ne produit pas seulement de la médiocrité : elle produit de la servitude. Les slogans tiennent lieu d’arguments, l’opinion remplace la réflexion, et le divertissement supplante le savoir. La politique devient un concours de communication où l’image l’emporte sur l’idée, où le scandale efface le débat, où l’émotion écrase la raison. Voilà où nous en sommes.
Il ne suffit pas d’avoir quelques génies isolés pour sauver une nation. Il faut une culture partagée, qui traverse l’école, les médias, les institutions, et qui forme des citoyens capables de penser par eux-mêmes. Aujourd’hui, la jeunesse israélienne grandit trop souvent sans philosophie, sans littérature, sans histoire universelle. On apprend à coder, on apprend à survivre, mais on n’apprend pas à réfléchir, à débattre, à comprendre le monde dans sa profondeur. Ce déficit est mortel. Car un peuple qui ne sait pas penser par lui-même finit toujours par être pensé par d’autres. Nous devons dire les choses clairement : l’inculture est devenue un mode de gouvernement. Les élites politiques ne sont pas seulement victimes de ce système, elles en sont complices. Elles ont tout intérêt à maintenir un peuple passif, occupé par les réseaux sociaux, hypnotisé par les chaînes d’information en continu, abruti par les polémiques artificielles. Une population qui ne lit pas, qui n’étudie pas, qui ne questionne pas ses propres sources, est plus facile à manipuler. La politique israélienne s’est donc adaptée à ce désert culturel : elle ne cherche plus à élever, mais à abaisser. Elle ne cherche plus à instruire, mais à séduire.
Cette situation est une trahison de l’idéal sioniste. Car le sionisme n’était pas seulement un projet de refuge ou de survie : il était une renaissance intellectuelle et spirituelle, un retour à la langue hébraïque, aux textes, à la pensée, à la culture. Herzl écrivait, Ahad Ha-Am rêvait, Bialik enseignait : tous voyaient dans le retour à Sion une renaissance de la culture autant qu’un projet politique. Israël ne devait pas être seulement un État, il devait être une civilisation. Aujourd’hui, cet idéal est menacé. La civilisation hébraïque, au lieu de rayonner, se replie. Elle se contente d’une survie médiocre, dominée par des élites médiatiques et militaires sans vision. La richesse des savoirs bibliques, talmudiques, philosophiques, littéraires est réduite à un folklore ou à un décor. La culture générale, au lieu d’être un socle, est traitée comme un luxe inutile. Nous vivons une régression.
Mais il n’est pas trop tard. Ce constat peut être le point de départ d’un sursaut. Il faut restaurer la centralité du savoir, du débat, de l’étude et de la culture générale. Il faut remettre à l’honneur la philosophie, la littérature, l’histoire, la pensée juive et universelle, dans nos écoles, dans nos universités, mais aussi dans l’espace public et dans le discours politique. Il faut cesser de confondre politique et spectacle, et exiger des partis qu’ils cessent d’être des tremplins pour carrières individuelles. Une nation n’est forte que lorsqu’elle est habitée par une culture collective. Israël ne peut pas survivre uniquement sur ses succès militaires ou technologiques : il a besoin d’une vision, d’une profondeur, d’une sagesse partagée. Sans cela, il deviendra une coquille vide, une démocratie réduite à un théâtre de marionnettes. Nous devons dire haut et fort : Israël n’est pas destiné à être une nation aveugle. Il est destiné à être un peuple sage et intelligent, une lumière pour les nations, une société qui sait que sans savoir, sans culture et sans mémoire, il n’y a pas d’existence véritable. Seule une sagesse collective, enracinée à la fois dans nos sources hébraïques et dans la culture universelle, peut nous permettre de tenir debout dans un monde en tempête.
L’heure est venue de nous réveiller. De redonner à l’étude sa place centrale. De réapprendre à lire nos prophètes et nos philosophes, mais aussi les grandes voix de l’humanité. De réconcilier Israël avec son destin : celui d’un peuple qui ne se contente pas de survivre, mais qui pense, qui crée, qui enseigne, qui éclaire. Ce manifeste n’est pas un cri de nostalgie : il est un appel à l’action. Il nous revient de refuser la médiocratie, de dénoncer le nivellement par le bas, de reconstruire une culture collective de savoir. Sans cela, Israël ne sera qu’un État fragile, condamné à subir son temps. Avec cela, il peut redevenir ce qu’il doit être : un phare de sagesse et de liberté.